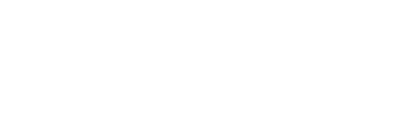Le droit de résistance à l’oppression pour les nuls !
Le droit de résistance à l’oppression, est bien la Liberté fondamentale pour les êtres humains qui a été la moins codifiée par nos hommes de loi, et pour cause, elle relève du suicide politique pour nombre d’entre eux…
Elle apparaît cependant pour la première fois en 1787 sous la forme d’un article de loi constitutionnelle, mais qui paraîtra très ambiguë pour un Français du XXIème siècle. En effet, il s’agit du second amendement de la « Bill of right » étasunienne - loi sur les droits – qui dispose que :
« Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne pourra être porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes. »
Il faut tout d’abord s’accorder sur la sémantique et se rappeler qu’une milice signifie une armée de civils encadrés par des militaires. A la base du Système républicain, l’on considère qu’un peuple en arme oppose directement la souveraineté qu’il détient de fait sur son armée, pour assagir son corps politique lorsque cela s’avère nécessaire. Interdire donc le port d’arme dans les plus dangereux ghettos des U.S.A comme l’interdire dans la très paisible Suisse, c’est attaquer le droit fondamental pour les citoyens de ces deux contrées, de résister tant à une oppression étrangère, qu’à une oppression intérieure…
Ainsi, dans son caractère le plus absolu – et on peut le comprendre dans certaines situations où c’est l’oppression d’un despote cruel qu’un peuple subit – le droit de résistance à l’oppression inscrit dans l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, a permis à notre nation de prendre les armes pour trancher la tête d’un Roy, repousser une invasion Germano-Autrichienne, et défaire les élites qui l’avaient à nouveau trahit.
Un peuple intrinsèquement relié à son Armée (au départ par le principe de conscription obligatoire), est forcément plus influent sur les décisions de son État-major Militaire pour décider du sort de ses élites politiques. C’est ce qui explique que Napoléon, Pétain ou De Gaulle eurent la faveur du peuple Français en leur temps pour mettre un terme à de graves crises intérieures ou étrangères. Leur popularité ne tenait pas seulement d’une presse favorable – qui ne l’était pas toujours du reste – mais surtout d’une réelle reconnaissance de leurs soldats qui étaient pour la plupart des civils tenus aux obligations de conscription pour défendre la patrie. Les succès militaires de ces commandants, mais aussi leur façon de se comporter avec leurs hommes restaient en mémoire bien des années après la fin de la guerre. Une armée de milice comme celle que possède la Suisse est ainsi non seulement la garantie d’une considération très défensive (et non agressive) d’un territoire politique et de ses concitoyens, mais s’avère en outre un atout démocratique très élevé dans une Constitution qui se voudrait progressiste.
Le problème étant qu’en 1789, ce n’était pas encore une Révolution populaire qui survenait, mais plutôt une révolte de la très fortunée bourgeoisie de commerce et de spéculation de l’époque, contre l’ordre aristocratique ancien (dont la famille royale était au sommet). Il fallait s’attirer la sympathie de la foule, mais ne surtout pas donner à la populace le pouvoir de faire valoir son droit de résistance à l’oppression contre ses nouveaux maîtres. Et afin que certaines des grandes idées des Lumières qui inondaient les faubourgs et les villages du vieux Royaume de France ne deviennent pas une contrainte pour la bourgeoisie désireuse de pouvoir politique, cette dernière annihila par l’astuce juridique la portée du droit de résistance à l’oppression dans la première déclaration des droits de l’homme. Ainsi, l’article portant sur le droit de résistance à l’oppression et qui a une portée constitutionnelle (a valeur de loi) en France, est rédigé comme suit :
Art. 2 DdlH de 1789 :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression« .
L’astuce juridique – mais de taille – réside dans le fait qu’offrir aux associations politiques (forcément opposées entre elles) le droit exclusif de se faire reconnaître comme dépositaires de la conservation du droit de résistance à l’oppression, relève tout simplement de la farce, si l’on considère que la résistance, elle, ne commence que lorsqu’un peuple est unifié.
Les associations politiques ne défendant rien d’autre que leurs idéologies propres, ne sont pas de nature à se fédérer tant qu’une crise majeure n’impose pas à chaque citoyen au-delà de ses dissensions partisanes, religieuses ou morales de mettre provisoirement fin aux querelles intestines qui l’opposent à son voisin, et faire bloc face à une oppression menaçant les vies de tous.
Or, la meilleure façon de régler une crise majeure telle qu’une guerre ou une révolution s’éternisant dans un bain de sang, c’est encore de pouvoir disposer du droit de résister à l’oppression bien avant que « la crise majeure » ne survienne. En effet, les épisodes les plus meurtriers d’une telle crise, ne sont que la conséquence de la rencontre entre une réalité sociale ou géopolitique avec le jeu de théâtre d’une ploutocratie en fin de règne.
Le désintéressement pour leur propre pays d’une génération de « fils de » qui étaient eux mêmes « fils de » ou encore amis de « fils de » ; amène inévitablement à une dégénérescence des considérations patriotiques et sociales des « fils de » ou « ami de » qui se retrouvent propulsés dans des partis politiques pour y faire une carrière avec le plus grand vide d’idéaux et d’altruisme qui soit.
C’est donc bien avant que les crises surviennent – et qui imposent de fait à un peuple de prendre les armes pour évincer les politiciens l’ayant mené à la catastrophe – que le droit de résistance à l’oppression doit pouvoir s’exercer naturellement, c’est à dire sans la contrainte des partis politiques pour désunir la nation continuellement.
Et c’est possible, car le droit de résistance à l’oppression trouve sa transposition en droit pénal au travers du principe de « l’état de nécessité ». Il s’agit de l’article 122-7 du Code pénal et il est rédigé comme suit :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »
Pour bien comprendre de quoi nous parlons, rien ne vaut une citation d’un site de référence pour illustrer des cas concrets où l’état de nécessité a été invoqué avec succès pour un prévenu :
« Le premier arrêt en ce sens est un arrêt Dame Ménard. Il s’agissait d’une mère de famille, vivant dans la misère, qui avait volé un pain. Elle a invoqué la nécessité de se nourrir et de nourrir ses enfants. Elle a été relaxée. En 1956, le Tribunal correctionnel de Colmar a admis cet état de nécessité pour un père qui avait construit une cabane pour protéger sa famille du froid. Il a été poursuivi pour construction sans permis de construire. Le tribunal a reconnu que le père avait agi sous l’empire de l’état de nécessité.
La Chambre criminelle a consacré en 1958 cette jurisprudence à propos d’un délit de coups et blessures involontaires. Il s’agissait d’un conducteur dont la portière avant-droite s’était ouverte. Cherchant à éviter d’écraser sa femme, il avait fait un écart à gauche et percuté un véhicule qui venait en sens inverse et dont le conducteur a été blessé. En appel, la Cour de Rennes a relaxé le conducteur en se fondant sur l’état de nécessité. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, non pas parce qu’elle désapprouvait l’état de nécessité, mais parce que la Cour d’appel n’avait pas vérifié que les conditions de l’état de nécessité étaient remplies. […]
Plusieurs fondements à ce fait justificatif ont été présentées. Certains ont dit que cette infraction ne comporte pas d’élément moral (argument dans l’arrêt Dame Ménard). Mais cet argument ne tient pas parce que l’élément moral, c’est le dol général, qui se définit comme la conscience de commettre une infraction. Une autre explication a été de dire que l’impunité s’explique par la contrainte. Or ça ne tient pas non plus. La personne en danger a le choix.
Dernière explication, l’impunité de l’auteur s’explique par l’utilité sociale. Elle permet d’éviter un danger plus grand. Entre deux danger, la société n’a pas intérêt à sanctionner un danger plus grand. La mort est un trouble à l’ordre public plus grand que l’excès de vitesse de l’ambulancier ».
Source : http://fr.jurispedia.org/
Ainsi, ce que les juristes du site jurispedia introduisent comme élément de philosophie du droit pour justifier l’état de nécessité, c’est l’utilité sociale. Et c’est sans doute ce qui a motivé l’arrêt d’un jugement (aujourd’hui cassé) rendu le 9 décembre 2005 à la faveur de 49 faucheurs OGM par le tribunal d’Orléans :
« Les prévenus rapportent la preuve qu’ils ont commis l’infraction de dégradation volontaire pour répondre à l’état de nécessité » (…). Cet état de nécessité résulterait de « la diffusion incontrôlée de gènes modifiés qui constitue un danger actuel et imminent, en ce sens qu’il peut être la source d’une contamination affectant des cultures traditionnelles ou biologiques » qui en déduit que « La commission d’une infraction pénale pour remédier à la situation de danger était en l’espèce fondée au regard des enjeux en cause » rappelant par ailleurs le droit « à valeur constitutionnelle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé pour les citoyens, ainsi qu’il a été reconnu dans la charte de l’environnement de 2004 ».
Ce jugement était ainsi fondé sur la nécessité de circonvenir – y compris par une infraction ou un délit – à un péril écologique actuel et imminent. L’imminence du péril est d’ailleurs un concept relativement large, puisqu’entre le fait de devoir abattre le gentil pitbull du voisin qui pensait faire festin de votre enfant à un instant T, et empêcher l’imminence d’une crise majeure telle qu’une guerre, une famine, une faillite financière ou toute autre crise pouvant déchaîner les ires populaires, rend la notion de temps excessivement relative. L’imminence d’une guerre du fait d’une situation géopolitique allant en se dégradant du fait même de la trahison et/ou le bellicisme d’une ploutocratie au pouvoir, ne se mesure ni en minutes, ni en heures, mais bien en années. Pour ne pas faciliter les choses, il y aura toujours la tentation d’éviter l’implacable rigueur juridique en détournant notre regard vers la légitimité institutionnelle des ploutocrates nous menant à la catastrophe et en faisant valoir que les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, l’étaient sur la base d’idées politiques censées être représentatives de la majorité des opinions par le jeu des élections.
Mais d’une part, l’on sait depuis longtemps que l’on élit seulement celle ou celui qui a l’argent et les réseaux nécessaires pour être entendu dans une campagne électorale ; et par ailleurs, lorsqu’il convient de parler d’un péril ou d’une oppression, l’on peut objectivement se référer à la loi. Ainsi, la haute trahison est par exemple codifiée par pas moins de 10 articles de lois du Code Pénal et qui auraient de quoi surprendre tous ceux qui au regard de décisions « politiques » de notre actuel président de la République, n’imaginaient pas que l’on avait à faire en vérité à des crimes valant dix années de réclusion criminelle pour François Hollande.
D’autant que la haute trahison est l’une des justifications morales, juridiques, sociales et politiques les plus évidentes pour un peuple de destituer son autorité politique suprême, y compris en commettant des infractions et délits si cela s’avère nécessaire. Et dans les cas où l’intensité de l’oppression relève du crime de masse plus que d’une somme de trahisons constantes de nature à accroître les vulnérabilités économiques, sociales et militaires d’un pays, il est une évidence que l’état de nécessité pour les citoyens, ira jusqu’à commettre certains crimes visant à mettre fin à « un péril actuel et imminent ».
En me contentant d’aborder le droit de résistance à l’oppression sur la base d’une minorité d’articles de loi existants sur le sujet, je tiens simplement à gagner du temps pour expliquer un problème philosophique et juridique majeur, en évitant d’énoncer une multitude de sources juridiques et historiques donnant un sens à peu près intelligible à cette liberté fondamentale.
La valeur du droit de résistance à l’oppression tient en France à deux acquis juridiques et philosophiques importants pour nos magistrats :
- Il existe deux articles de loi dans le droit Français – l’un dans le bloc de constitutionnalité, l’autre dans le code pénal – qui permettent à tout ou partie du peuple de commettre des infractions ou des délits, pour résister à une oppression intérieure ou extérieure.
- L’état de nécessité (qui est aussi un point de droit international) introduit des éléments tangibles pour arbitrer la décision d’un juge. Il s’agit de l’utilité sociale et le dommage mineur d’une infraction ou un délit face à l’intensité et l’imminence d’un péril.
 Voila pourquoi avec quelques dizaines d’autres aujourd’hui, je suis un activiste qui n’hésite pas à décrocher des drapeaux européens de frontons d’écoles ou mairies – ce qui est un vol – par ce que ce délit est porté contre un symbole de l’oppression de nombreux peuples en 2015, et que le préjudice est négligeable par rapport à l’intensité, l’actualité et l’imminence des périls vers lesquels nous entraînent les responsables nationaux et étrangers de l’oppression subie par 28 peuples en Europe. Bien entendu, il est fortement probable que les procès à venir tourneront en notre défaveur, mais ce n’est pas tant les magistrats qu’il s’agit pour nous de convaincre, mais bien tout un peuple.
Voila pourquoi avec quelques dizaines d’autres aujourd’hui, je suis un activiste qui n’hésite pas à décrocher des drapeaux européens de frontons d’écoles ou mairies – ce qui est un vol – par ce que ce délit est porté contre un symbole de l’oppression de nombreux peuples en 2015, et que le préjudice est négligeable par rapport à l’intensité, l’actualité et l’imminence des périls vers lesquels nous entraînent les responsables nationaux et étrangers de l’oppression subie par 28 peuples en Europe. Bien entendu, il est fortement probable que les procès à venir tourneront en notre défaveur, mais ce n’est pas tant les magistrats qu’il s’agit pour nous de convaincre, mais bien tout un peuple.
Car un dernier élément objectif achève de justifier la Résistance à l’oppression : c’est lorsque la résistance à la dite oppression n’est pas le fait d’un individu seul, mais bien d’un grand nombre de personnes (comme une association politique), voir par des millions (bien au-delà des effectifs d’un parti politique donc).
Supposons par exemple que des centaines de citoyens Français, nous imitent dans notre initiative, cela serait en soi suffisant pour démontrer que le sentiment d’oppression et de nécessité d’y résister par la déprédation ou le vol d’un objet symbolisant la dite oppression, est partagé par tout un corps politique. Mais là encore, un magistrat sûr de son pouvoir et sans doute lui-même politisé ou lié à des influences politiques, pourrait trouver matière à redire à une telle invocation de l’état de nécessité.
Mais si nous parlions de millions de Français, alors il n’y aurait même plus lieu d’envisager un quelconque procès. La résistance à l’oppression sortirait du cadre juridique pur pour entrer sur le terrain plus politique (au sens exact du terme). Les révolutionnaires évinçant leur Gouvernement et imposant provisoirement leur pouvoir politique de fait, ont alors tout loisir de proclamer par décret ou modification constitutionnelle, la légitimité de leur résistance et leur pouvoir obtenu dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
La question de la valeur juridique de l’invocation de l’état de nécessité par des révolutionnaires, n’est alors plus du ressort des magistrats, mais de la représentation politique des révolutionnaires au moment de la transition entre le corps politique renversé, et la prise de pouvoir des insurgés.
Il en ressort que s’il est possible d’offrir un cadre étendu et des exclusions nécessaires au droit de résistance à l’oppression pour que jamais ne soit justifiée la barbarie et l’arbitraire durant une légitime insurrection populaire, le droit de résistance à l’oppression reste très avare d’éléments d’appréciations imposant au Magistrat de se borner à ce que dit la loi, et non la seule philosophie du droit qui reste malléable lorsque des accointances partisanes troublent le jugement d’un tribunal.
C’est aussi pour cette raison, que si tous les Français (contrairement à l’écrasante majorité des peuples du Monde) disposent du droit constitutionnel de résister à toute oppression – y compris celle de leur Gouvernement – ces derniers ne peuvent faire valoir pour le moment leur résistance qu’après coup, à moins qu’un souffle de probité et d’indépendance morale devait pénétrer l’ensemble de notre magistrature. Il revient quoi qu’il en soit pour tous les Français un peu éveillés sur la chose géopolitique, l’économie ou le droit pénal et constitutionnel, de considérer la gravité des périls qui menacent leurs enfants et eux-mêmes d’ici à quelques années, et y d’y répondre de toutes les façons possibles avant qu’une « crise majeure » ne survienne…
La Résistance à l’oppression, c’est cela…
Sylvain Baron