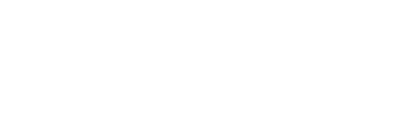Liberté est donnée aux enseignants d’endoctriner nos enfants…
Chers parents d’élèves,
Imaginez qu’un jour, votre enfant rentre de l’école et vous dise :
« Aujourd’hui, un monsieur du parti socialiste est venu dans notre classe. Il nous a expliqué pourquoi il fallait être socialiste, et il nous a dit que les gens qui votent pour l’UMP ou le Front National sont réactionnaires ».
Même si à titre personnel vous deviez avoir une sympathie pour le parti socialiste, la logique voudrait que vous soyez choqué(e) que des points de vue politiques viennent s’immiscer à l’école.
En effet, l’enfant se distingue d’un individu adulte par des contraintes qui ne s’exercent qu’à lui :
-
L’enfant jusqu’à sa majorité, est soumis à l’autorité des adultes responsables de son éducation. Cela commence bien évidemment par les parents, mais aussi par le corps enseignant qui est d’ailleurs responsable des dommages causés par les élèves placés sous sa surveillance.
De façon générale, l’on apprend très tôt à un enfant à respecter l’autorité des adultes et nous les plaçons dans une position de subordination, quand bien même nous leur apprenons à se méfier des agissements de certains adultes pour des raisons de sécurité évidente.
Ce qui fait que globalement, un enfant accorde sa confiance à un adulte (plus encore s’agissant de ses parents ou ses enseignants lui prodiguant un savoir) et n’est pas apte à remettre en cause une telle autorité. Ajoutons que le Code Pénal considère qu’un crime commis contre un enfant est une circonstance aggravante, du fait que ce dernier est reconnu comme étant « vulnérable ».
-
L’enfant ne jouit pas des connaissances acquises par les adultes, que ce soit par l’instruction qui ne lui a pas encore été prodiguée en milieu scolaire, ou encore l’expérience de vie hors du cadre scolaire. Il ne peut donc pas exercer ses facultés critiques à leur plein potentiel, contrairement à un adulte.
-
Enfin un individu n’acquiert sa liberté de vote (et donc d’esprit critique) qu’une fois sa majorité atteinte. Si la loi ne reconnaît pas à un gamin de sept ans le droit de voter, c’est qu’implicitement elle considère qu’en dessous d’un certain âge, l’aptitude à exercer sa citoyenneté et s’informer de façon critique n’est toujours pas acquise.
A ce titre, s’il est tout à fait normal de reconnaître aux enseignants le droit d’exprimer leurs opinions politiques en dehors du cadre scolaire, la logique voudrait qu’il leur soit expressément interdit de faire valoir ces opinions aux enfants dont ils ont la charge durant leur service.
Et d’ailleurs, la plupart d’entre nous sommes convaincus que le devoir de réserve s’applique à l’école. Rien n’est plus faux ! La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Anicet Le Pors portant sur les droits et devoirs des fonctionnaires, n’a jamais retenu l’amendement qui avait été proposé à l’époque, introduisant le devoir de réserve. Les statuts des enseignants ne mentionnent aucunement cette obligation, pas plus que le Code de l’Éducation.
La seule mention concernant le devoir de réserve dont doivent se prévaloir les fonctionnaires en général, se trouve sur « le portail internet du service public » et est rédigée comme suit :
« Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif ».
Mais cela n’a pas valeur de loi, puisque non codifié dans un texte juridique.
La seule loi qui est censée protéger nos enfants de l’importation de tous repères idéologiques particuliers à l’école est l’article L.141-6 du Code de l’éducation, mais qui ne vaut que pour l’enseignement supérieur, soit celui prodigué à de jeunes gens ayant souvent dépassé l’âge de la majorité. Il est rédigé comme suit :
Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
En clair, un enseignant s’il ne peut pas débattre librement de ses opinions avec des étudiants pouvant avoir largement dépassé la vingtaine d’années, son collègue travaillant dans l’enseignement du primaire, peut en revanche dire strictement ce qu’il veut à des bambins de sept ans dans sa salle de classe. Et force est de constater que des points de vue politiques particuliers s’immiscent désormais à l’école depuis la réforme de l’éducation nationale en 2013 par Vincent Peillon.
En effet, si ce qui a fait le plus de tapage médiatique est l’introduction du concept fumeux de la théorie du genre dans les salles de classe, d’autres points de vue politiques passent plus inaperçus.
Commençons par un indice provenant directement de la réforme Peillon, à savoir l’article L.111-1-1 du Code de l’éducation qui dispose que :
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.
Quelques éléments sont à savoir s’agissant de ce drapeau :
-
La Constitution de la République Française ne reconnaît qu’un seul emblème : le drapeau bleu, blanc, rouge. Cet article de loi viole donc la constitution.
-
La circulaire n° 246 du 4 mai 1963 évoque la possibilité en certaines circonstances, d’ériger l’emblème adopté par le Conseil de l’Europe en 1955. Mais attention, le Conseil de l’Europe n’a strictement rien à voire avec l’Union Européenne, puisque cette première institution concerne 48 pays. La Russie, la Norvège et la Suisse qui ne sont pas dans l’Union Européenne y siègent par exemple. Et s’il est vrai qu’à l’époque, l’emblème adopté par le Conseil de l’Europe était le même que celui de l’Union Européenne aujourd’hui, désormais, cet emblème a changé afin de distinguer les deux institutions (voire illustration)
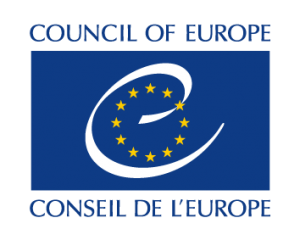
-
Une autre circulaire est encore plus explicite sur la primauté de l’esprit républicain sur les idéologies politiques particulières concernant les drapeaux :
La circulaire N° 70-416 du 27 Octobre 1970 dispose en effet que : les exhibitions sur la voie publique d’insignes ou d’emblèmes associés aux couleurs nationales, sont d’une manière générale, de nature à compromettre la sûreté et la tranquillité publique ; elles peuvent dont être interdites et que : […] L’éventualité de l’exhibition ou l’utilisation, sur la voie publique, de l’emblème national, associé à des emblèmes ou insignes présentant un caractère politique ou religieux soit lors de cortèges, défilés et rassemblements, soir lors de quêtes, dans des conditions de nature à entraîner de la part d’une catégorie de citoyens, des réactions créatrices de troubles de l’ordre public, doit conduire les Maires à refuser d’autoriser ou à interdire la quête ou manifestation envisagée ;
A ce stade, rappelons que près de 55 % des Français avaient voté non au Référendum portant sur le projet de Traité Constitutionnel Européen qui reprenait l’intégralité des traités votés précédemment. En clair, les Français se sont prononcés à la majorité contre l’ensemble des traités européens ayant pré-existé en plus des textes nouveaux qui leur étaient soumis. Ce qui fait de l’idéologie « européïste » une thèse politique minoritaire en France. Plus encore, nous devrions en vertu du droit constitutionnel être sortis de l’Union européenne depuis cette date.
-
Enfin ajoutons que lors de la forfaiture de Lisbonne, éclair de conscience ou simple oubli du Gouvernement Français, l’article 52 des déclarations annexées au Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne portant reconnaissance des emblèmes européens (le drapeau, l’euro, la journée de l’Europe et l’hymne européen) n’a pas été signé par la France et le Royaume-Uni.
Ce qui fait que de tous les points de vue juridiques possibles, le drapeau européen est illégal sur le territoire. L’introduction de l’article 111-1-1 dans le Code de l’éducation par M. Peillon viole donc non seulement l’esprit de la loi, mais aussi sa lettre.
A ce stade de ce petit cours de droit, il convient de s’intéresser un peu à ce traité pour lequel nous avions dit non. Le Traité de Lisbonne est en vérité scindé en deux traités différents. Le premier s’appelle « le Traité sur l’Union Européenne » et nous n’en parlerons pas ici. Le second (celui qui est responsable de toutes les dérégulations économiques en France) s’intitule « le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne » (ou T.F.U.E).
L’article 3 de ce traité traite des compétences exclusives accordées à l’Union Européenne (en clair, les pans de notre Souveraineté populaire que nos politiciens ont sabordé au profit de cette institution).
L’article 4, traite pour sa part des compétences partagées.
Aucun de ces deux articles ne portent sur l’éducation nationale.
C’est l’article 6 du même traité qui en parle de la façon suivante : « l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États-membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : […] l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ».
D’abord relevons que cet article de traité est extrêmement flou, puisqu’il n’édicte pas les limites de cette « compétence ». Ce qui n’a pas semble-t-il dérangé M. Peillon, puisque ce dernier ne s’est pas montré avare de références à l’Union européenne dans sa réforme.
Ainsi l’article L.121-1 du Code de l’éducation dispose que :
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur […] dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. […]
Ce qui est souligné ici est une volonté politique importée à l’école. S’il est effectivement naturel de dispenser des savoirs sur le monde qui nous entoure, il est très aisé de transformer la neutralité de l’enseignement en propagande politique. L’évolution économique, comment est-elle présentée exactement ? Les choix qui ont été faits depuis les années 1970 et gravés dans le marbre des traités, comment sont-ils traités par les enseignants et par les manuels scolaires ?
Autre phrase importante de l’article L.121-1, celle qui porte sur les langues et cultures régionales. A savoir que la langue de la République est le Français. Qu’il a fallu des siècles à notre pays pour se construire dans la douleur et finalement s’unifier avec un socle culturel et linguistique commun. Cette volonté de régionaliser la France jusque dans l’enseignement de langues quasi éteintes et de « repères culturels régionaux » n’est pas sans conséquence concernant l’unité du peuple Français et l’indivisibilité de la République. Ce sont encore une fois des choix politiques importés à l’école. Et il se trouve que cette politique de « régionalisation » de la France est tout droit importée des institutions européennes. Comme il est impossible de traiter de tous les sujets en un seul article, je ne puis que vous inciter à prendre connaissance de la politique des « euro-régions ». Toute une littérature existe à ce sujet, mais évidemment, personne n’en entend parler à la télévision malgré les questions importantes qu’elle soulève.
Un autre texte (que nous ne devons pas à M. Peillon) mentionne l’influence des institutions européennes dans l’éducation nationale. Il s’agit d’un décret signé Gilles de Robien publié le 11 juillet 2006 et disposant entre autre que :
« Le socle commun est le ciment de la nation : il s’agit d’un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l’acquisition repose sur la mobilisation de l’école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance.
La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne en matière de compétences clés pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie »
 Donc l’Union européenne fait bien valoir sa « compétence » en matière d’éducation, notamment au travers du processus de Bologne, qui globalement considère que l’enseignement doit favoriser d’une part la fuite des cerveaux à l’étranger en faisant des savoirs acquis aux frais de la Nation, un marché que des multinationales peuvent s’accaparer ; et d’une autre part que le principe d’égalité face à l’éducation ne peut pas être atteint, et que les élèves les plus en difficulté se doivent d’être orientés préférentiellement dans des formations qualifiantes. Ceci n’est pas la conception de l’idéal républicain qui vise plutôt à soutenir les élèves les plus en difficulté pour qu’ils puissent rattraper les autres et disposer du droit de s’acheminer vers des études supérieures comme tout le monde. Mais lorsque le mot « compétitivité » arrive jusque dans les textes des technocrates européens s’agissant de l’école, on se doute que la conception républicaine de l’enseignement est le cadet de leurs soucis.
Donc l’Union européenne fait bien valoir sa « compétence » en matière d’éducation, notamment au travers du processus de Bologne, qui globalement considère que l’enseignement doit favoriser d’une part la fuite des cerveaux à l’étranger en faisant des savoirs acquis aux frais de la Nation, un marché que des multinationales peuvent s’accaparer ; et d’une autre part que le principe d’égalité face à l’éducation ne peut pas être atteint, et que les élèves les plus en difficulté se doivent d’être orientés préférentiellement dans des formations qualifiantes. Ceci n’est pas la conception de l’idéal républicain qui vise plutôt à soutenir les élèves les plus en difficulté pour qu’ils puissent rattraper les autres et disposer du droit de s’acheminer vers des études supérieures comme tout le monde. Mais lorsque le mot « compétitivité » arrive jusque dans les textes des technocrates européens s’agissant de l’école, on se doute que la conception républicaine de l’enseignement est le cadet de leurs soucis.
Nous arrivons désormais à la dernière partie de cet article, celle qui est le sujet de ma profonde indignation. En effet, jusque là nous n’avons fait que survoler l’intrication de l’Union européenne à l’école sans trop nous attarder sur le terrain idéologique, c’est à dire profondément politique.
Imaginons que nous amendions souverainement l’article L.141-6 du Code de l’éducation en lui supprimant le seul mot « supérieur ». Voila ce que cela donnerait :
Le service public de l’enseignement est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Voila un article de loi désormais plus soucieux de la « vulnérabilité » des enfants en bas-âge, face à toute emprise politique de l’enseignement.
Concrètement, cela signifierait qu’il serait interdit à toute formation politique de venir discourir dans une salle de classe, ou à un enseignant de faire valoir ses opinions politiques propres à ses élèves.
Cela n’interdirait pour autant pas à des personnes représentant des institutions, de venir expliquer comment ces dernières fonctionnent (ou dysfonctionnent si l’on considère que l’exercice critique est une nécessité dans l’enseignement).
Sur le site du « Mouvement des jeunes européens », nous pouvons trouver la rubrique « L’Europe à l’école ». Voila comment est décrit ce programme :
Développé depuis 1999, le programme « L’Europe à l’Ecole » cherche à expliciter les enjeux du projet européen et à susciter l’envie des jeunes collégiens et lycéens de prendre part à l’aventure européenne. Depuis 2005, le programme « L’Europe à l’école » est parrainé par le Ministère de l’Éducation nationale.
Mais qu’est ce que « le Mouvement des Jeunes Européens » au juste ? Est ce une association neutre évoquant les « intérêts » et difficultés de l’Union Européenne ?
Il suffit de lire l’article 3 des statuts de cette association pour savoir de quoi il retourne :
 L’association « Les Jeunes Européens-France » a pour objet de rassembler les Jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne et de promouvoir une union politique fédérale européenne.
L’association « Les Jeunes Européens-France » a pour objet de rassembler les Jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne et de promouvoir une union politique fédérale européenne.
Cela ressemble donc très fortement à un parti politique n’est-il pas ? Et d’ailleurs, allons jusqu’au bout de la preuve juridique à ce sujet. L’article 2 des mêmes statuts précise :
L’association adhère au Mouvement Européen-France dont elle respecte les principes, notamment le pluralisme qui lui interdit toute action politique partisane, et avec laquelle, elle établit une relation contractuelle.
L’association constitue la section française des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) et assume les obligations qui en découlent.
Reportons nous cette fois-ci aux statuts du Mouvement Européen-France et notamment son article 1 :
L’Association dite Mouvement Européen-France (ME-F), anciennement Organisation française du Mouvement Européen, fondée en février 1949, a pour but de développer en France l’information et la pédagogie sur l’Europe et son histoire, la prise de conscience de l’identité européenne, de la communauté de destin des peuples qui composent l’Europe et de contribuer à la réalisation d’une Union politique à caractère fédéral. L’Association a également pour but de regrouper les associations à vocation européenne, afin de renforcer leurs actions et de collaborer pour atteindre les objectifs communs, d’animer des instances de réflexion et de proposition.
En clair, le mouvement des jeunes européens peut tout à fait être comparé aux « jeunes socialistes » ou encore aux « jeunes populaires », émanation de l’UMP.
Nous parlons bien de partis politiques qui viennent faire propagande à l’école !
Et cela sous le haut-parrainage du Ministère de l’éducation nationale. Rappelons encore une fois l’esprit de la loi à ce sujet :
Le service public de l’enseignement est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Si ce n’est pas un viol de la loi, du moins de son esprit par les établissements scolaires et leur ministère de tutelle, alors qu’est ce d’autre ? Imagine-t-on le Front National venir expliquer les « enjeux et susciter l’envie à de jeunes collégiens et lycéens concernant la peine de mort ? »
Je ne ferais pas ici le procès de l’Union européenne pour expliquer le totalitarisme de l’institution et des fous qui la promeuvent. Je rappellerais simplement que les Français sont à ce point conscients de sa nocivité, que l’ensemble des sondages portant sur cette institution démontrent la croissance de l’euroscepticisme pour ne pas dire le rejet clair de l’U.E par plus de la moitié des Français. Ce qui fut confirmé par le Référendum de 2005.
Pour autant, ce référendum (comme celui des Pays-Bas sur le même traité) a été violé, et cela au mépris de notre Constitution qui considère le référendum comme décisionnaire. La Construction européenne ne répond en rien d’un processus démocratique. Elle se fait contre les peuples, et se fiche de leur consentement. A ce stade, je tiens à conclure par un petit rappel à l’histoire, tiré d’une étude de Claire Aslangul, Maître de conférence à Paris IV :
 « La croix gammée est omniprésente sur tous les supports.
« La croix gammée est omniprésente sur tous les supports.
Sous l’ère hitlérienne, devenue le symbole du NSDAP, on la trouve bien entendu sur la façade des établissements et institutions publiques, mais aussi dans les écoles, sur les innombrables drapeaux dans la rue, et sur toutes sortes d’objets du quotidien qui permettent que la présence par procuration du Führer se fasse sentir, à chaque moment, dans la sphère privée ».
 Chacun en tirera les conclusions qu’il souhaite…
Chacun en tirera les conclusions qu’il souhaite…
Sylvain Baron